La guerre technologique s’inscrit dans une stratégie globale des États-Unis visant à contenir la Chine et à l’empêcher de les dépasser en tant que première puissance économique mondiale. Ce qui avait commencé discrètement comme un différend commercial s’est peu à peu révélé comme une tentative systématique d’affaiblir des secteurs clés de l’économie chinoise et de freiner sa croissance.
La technologie constitue le principal front de ce conflit, car elle détermine le pouvoir économique, militaire et géopolitique du XXIe siècle. Dans ce contexte, la domination dans des domaines comme l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le calcul quantique, les réseaux 5G et la biotechnologie ne relève pas seulement de l’innovation, mais constitue la base du contrôle mondial exercé par les États-Unis. Face à cette pression, la Chine a fait du code ouvert un outil stratégique pour résister, progresser et rompre sa dépendance au modèle technologique occidental.
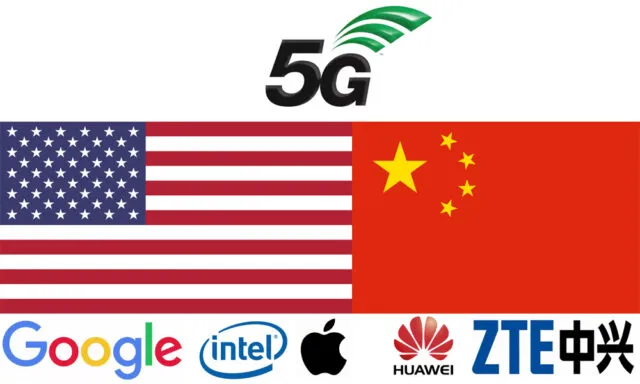
Depuis 2018, l’offensive de Washington contre Pékin s’est intensifiée. Sous la première administration Trump, des sanctions ont été imposées à des entreprises clés comme Huawei, ZTE et SMIC, au nom de la sécurité nationale. Avec l’arrivée de Biden, loin de s’assouplir, les restrictions se sont étendues. Aujourd’hui, à nouveau sous Trump, la Chine se voit bloquer l’accès aux puces avancées fabriquées avec des technologies américaines, et ses entreprises sont exclues des plateformes mondiales essentielles. Même des alliés comme le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni ou l’Allemagne ont rejoint, sous pression de Washington, la campagne visant à exclure les entreprises chinoises de leurs réseaux de télécommunications et projets technologiques stratégiques.
L’objectif des États-Unis est clair : conserver leur leadership technologique mondial, empêcher l’ascension de la Chine et consolider leur domination sur les infrastructures critiques de demain. Toutefois, cette politique de confinement a eu des effets inattendus. D’une part, elle a poussé la Chine à accélérer sa quête d’autosuffisance. D’autre part, elle a nourri une fragmentation de l’écosystème numérique mondial, avec l’émergence de standards parallèles, de chaînes d’approvisionnement dupliquées et de blocs technologiques de plus en plus isolés les uns des autres.

Face à cet encerclement, Pékin a élaboré une réponse alliant investissements massifs, planification étatique et ouverture technologique. L’initiative Made in China 2025 n’en est que la partie émergée. Ces cinq dernières années, le pays a multiplié ses dépenses en R&D, créé des dizaines de fonds d’investissement publics et encouragé la création de startups dans des secteurs stratégiques. Mais le plus intéressant est son pari systématique sur le développement de technologies en code ouvert. Le logiciel libre, longtemps porté par des communautés de programmeurs bénévoles, devient désormais un instrument de souveraineté nationale pour les pays du Sud global.
Les exemples de cette stratégie abondent. Huawei a transformé son système d’exploitation HarmonyOS en OpenHarmony, une plateforme open source destinée à remplacer Android et Windows sur les appareils connectés à l’internet des objets. Ce mouvement permet non seulement de contourner les sanctions, mais aussi d’ouvrir l’infrastructure à des milliers de développeurs chinois et étrangers. Un autre exemple est Deepin, une distribution Linux entièrement développée en Chine, avec une interface moderne et adaptée au marché local.
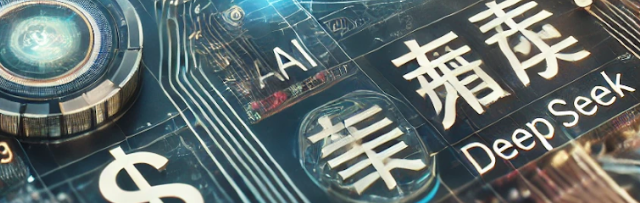
L’intelligence artificielle est un autre domaine dans lequel la Chine construit son indépendance à l’aide d’outils ouverts. Le modèle DeepSeek, lancé récemment, rivalise avec ceux d’OpenAI et de Google en termes de performance, mais offre une ouverture et un accès gratuit, ce qui a favorisé son adoption dans les milieux académiques et professionnels. À cela s’ajoutent les frameworks d’apprentissage profond PaddlePaddle (de Baidu) et OneFlow (d’Alibaba), conçus pour entraîner des modèles sur des architectures matérielles chinoises.
Un élément central entre alors en jeu : la maîtrise des GPU, les unités de traitement graphique essentielles à l’entraînement des modèles d’IA. Jusqu’à présent, Nvidia détenait le monopole de cette technologie avec sa plateforme CUDA, puissante mais exclusive : elle ne fonctionne qu’avec du matériel Nvidia, soumis aux restrictions à l’exportation. En réponse, la Chine a développé CunA, une architecture maison compatible avec des puces locales comme Huawei Ascend, Cambricon ou Iluvatar. CunA permet d’effectuer des tâches de calcul intensif sans dépendre de logiciels américains, et est compatible avec les frameworks chinois mentionnés plus haut.

Cette indépendance technologique ne se limite pas aux logiciels. Dans le domaine du matériel, la Chine mise sur RISC-V, une architecture de processeurs en open source qui concurrence ARM et x86. N’exigeant ni licence ni autorisation d’une entreprise étrangère, RISC-V permet aux concepteurs chinois de créer des puces personnalisées sans risques juridiques ni blocages externes. Le gouvernement en encourage l’usage dans des secteurs tels que la défense, les infrastructures critiques et l’éducation.
Par ailleurs, afin de ne pas dépendre de plateformes comme GitHub — propriété de Microsoft et donc soumise à la législation américaine —, la Chine a développé Gitee, son propre dépôt national de code source. Gitee garantit la continuité des projets technologiques chinois et favorise un écosystème plus sûr, aligné sur les priorités nationales.
Si l’on observe les grands indicateurs, les premiers effets de cette nouvelle guerre technologique et commerciale initiée par Trump sont déjà visibles à l’échelle de l’économie mondiale. Alors que les États-Unis connaissent un ralentissement économique, avec une baisse de 0,3 % de leur PIB au premier trimestre 2025, la Chine a enregistré une croissance de 5,4 %. En matière de commerce international, les exportations chinoises ont augmenté de 9,3 % en avril, preuve que le pays a su se diversifier et réduire sa vulnérabilité face aux droits de douane américains. Bien que les ventes vers les États-Unis aient diminué de 1,5 %, cet impact a été compensé par d’autres marchés.
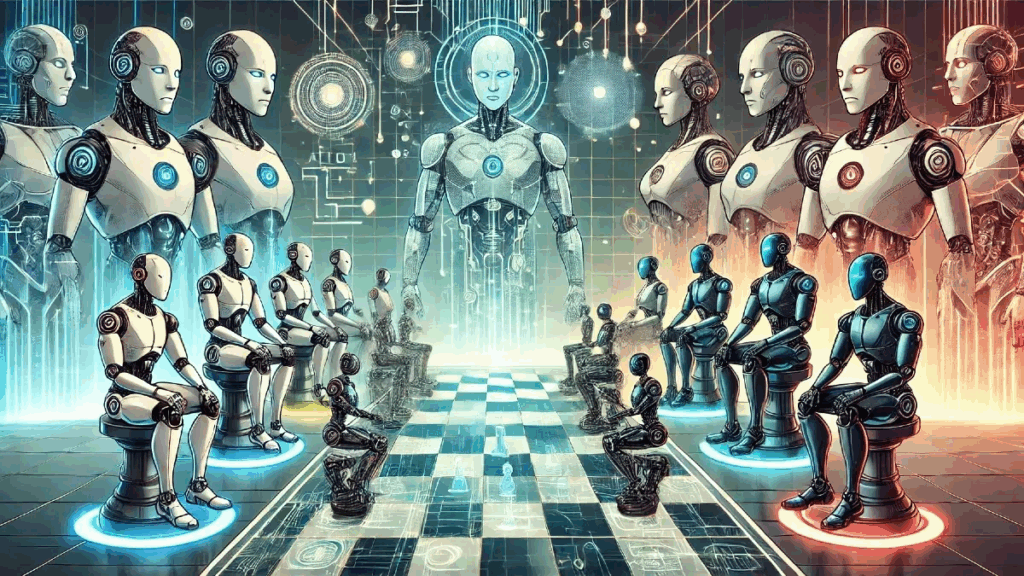
À l’échelle mondiale, on assiste à une polarisation technologique croissante. Les dispositifs, applications et plateformes utilisés en Chine ne sont plus les mêmes qu’en Occident. Là où dominaient autrefois Google, Microsoft ou Nvidia, ce sont désormais Baidu, Huawei et des plateformes chinoises ouvertes qui gagnent du terrain. Ce qui est en jeu n’est pas seulement la suprématie économique, mais la manière dont la technologie est structurée et répartie à l’échelle mondiale.
Le choix du code ouvert n’est pas anodin. La Chine a compris que l’accès partagé à la connaissance technique constitue un avantage stratégique. Il renforce sa résilience face aux sanctions, lui permet d’attirer des développeurs d’autres pays, de gagner en légitimité internationale et d’offrir une alternative crédible à l’hégémonie numérique des États-Unis. Ouvrir le code devient ainsi un moyen de fermer la porte à la domination absolue de la Silicon Valley.
Dans ce nouveau contexte, les États-Unis risquent de s’enfermer dans un modèle fermé, exclusif et de moins en moins compétitif. Tandis que l’innovation chinoise progresse portée par des millions de développeurs et une politique étatique cohérente, le pays qui fut le chef de file de la révolution numérique semble perdre du terrain.
La guerre technologique ne se livre pas uniquement à coups de sanctions ou avec du matériel de pointe. Elle se joue aussi dans les dépôts de code, les licences libres, les architectures ouvertes et la capacité à construire des alliances technologiques mondiales. Et sur ce terrain, la Chine agit avec une vision tournée vers l’avenir.
Par Pedro Barragán, économiste et expert en relations internationales.
Traduit de l’article Código abierto frente al supremacismo tecnológico occidental (LoQueSomos)